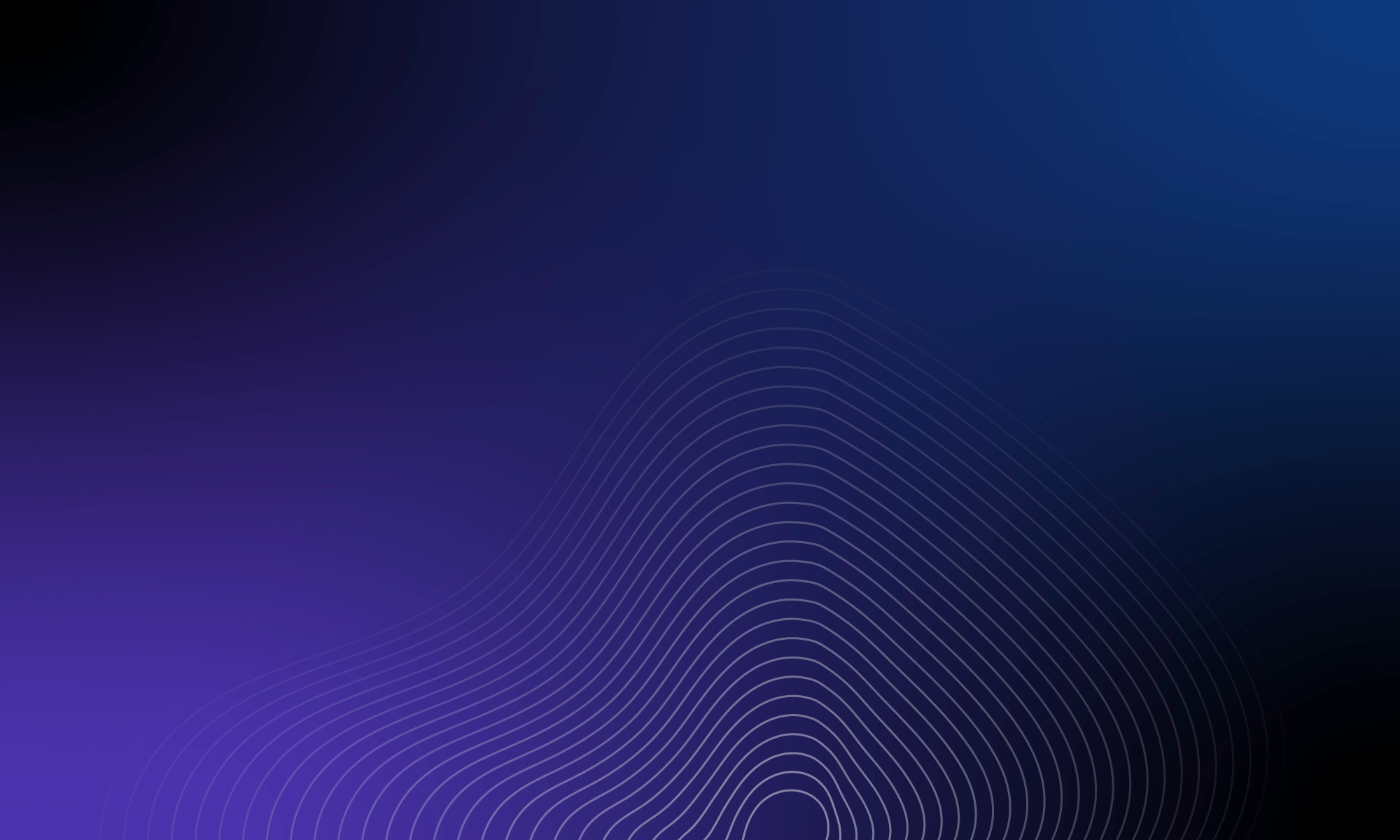Énoncé en 1971 par Herbert Simon, futur prix Nobel d’économie, le concept d’économie de l’attention est une branche des sciences économiques. Il place l’attention du consommateur sur un piédestal et la considère comme quelque chose de rare et de précieux. À une époque de surabondance, les publicités, pour avoir réellement une utilité, doivent se retrouver sur des supports médiatiques divers mais surtout sur des contenus numériques et des sites web. On joue alors avec plusieurs facteurs pour attirer au mieux l’attention d’un individu en orientant ses choix grâce à des objectifs, qu’il se fixe lui-même. Dans ce qui nous intéresse, nous utilisons des stimulis comme des titres accrocheurs, des images et des vidéos, du contenu presque putaclic. Un néologisme péjoratif que l’on retrouve sur internet pour désigner un article ou une vidéo dont le titre est délibérément exagéré, afin d’attirer davantage de lecteurs ou de spectateurs. On retrouve aussi des principes comme le scroll infini qui en apparence n’ont rien de néfaste, mais qui en réalité suivent ce principe d’économie de l’attention. Lors de la conception d’une application, le choix de nombreux systèmes s’offre à l’UX designer, le choix d’un scroll infini n’est par conséquent jamais anodin.
Aza Razkin, l’inventeur du scroll infini, témoigne dans l’envoyé spécial du 10 septembre 2020 appelé « Les repentis des applis ». Selon lui, son invention peut être comparée à un puit sans fond dans lequel nous sommes jetés. Selon ses propres calculs, le scroll infini représente en temps passé chaque jour l’équivalent de 200 000 vies entière de perdues. Des chiffres astronomiques qui nous révèlent l’efficacité de ce dark pattern. Ce phénomène fût nommé sur Twitter, en octobre 2018, le Doomscrolling. Mais alors comment cela fonctionne ? Il ne suffit pas de connaître ce dark pattern pour s’en prémunir, car il nous touche inconsciemment. Le scroll infini, en premier lieu, fait perdre la notion de temps à l’utilisateur, un scroll en devient donc dix, puis cent, et ce, sans que l’on en ait conscience. L’invention du scroll infini semble avoir simplement éliminé l’action de passer à la page suivante, incontournable avant 2006. Cette simple action presque disparue avait tout de même un avantage, celui de créer un réflexe neuronal nous alertant du temps passé à naviguer sur internet. Avec le scroll infini, ce réflexe neuronal a été inhibé, nous faisant consommer les contenus en bien plus grande quantité sans que l’on s’en rende compte et contre notre gré.
Prenons pour exemple le réseau social TikTok. Lorsqu’on lance l’application, la première chose à laquelle nous sommes confrontés est soit du contenu posté par les utilisateurs de l’application, soit une publicité que l’on peut immédiatement scroller. Dès cet instant, nous sommes déjà lancés dans la boucle sans fin du scroll infini. Cependant, TikTok va plus loin avec son algorithme… Plus nous likons des vidéos, plus nous recevons des vidéos en accord avec nos centres d’intérêts.
En conséquence, nous restons sur l’application et elle emmagasine des informations supplémentaires sur notre personnalité et nos goûts, nous voilà dans le puit sans fond, le cercle sans fin.
Malheureusement, cela reflète également notre manière de consommer du contenu de nos jours. Il doit être court et divertissant de sorte que nous passions rapidement à autre chose, la consommation de contenu est devenue éphémère. Qui se souvient de la totalité des vidéos et des contenus visionnés en quittant une application comme TikTok ou Instagram ? La réponse est personne. Pour la simple et bonne raison que notre esprit se relâche et n’est plus en éveil durant ces phases. Notre rapport au contenu est devenu passif.